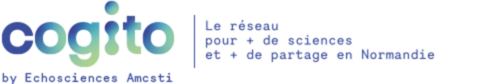"Bloquons tout", "grève générale" : quel rôle politique les grèves ont-elles joué en France depuis la fin du XIXe siècle ?
Publié par COGITO Normandie, le 10 septembre 2025 1.3k
Alors que le mouvement « Bloquons tout » appelle à paralyser le pays le 10 septembre, Jean-Luc Mélenchon appelle à la « grève générale ». Ce concept a joué un rôle majeur dans la rhétorique révolutionnaire du début du XXe siècle aux années 1970. Quel rôle ont joué les grèves dans l’histoire syndicale et politique française ? Quel sens leur donner aujourd’hui ?
par Stéphane Sirot, Professeur d'histoire politique et sociale du XXème siècle (CY Cergy Paris Université).
Si le recours à la grève n’est pas d’un usage spectaculairement plus marqué en France qu’ailleurs en Europe occidentale, la place qui lui a été attribuée dans l’histoire du mouvement ouvrier français n’en est pas moins singulière. Tout au moins dans la double acception que lui a donné un temps le champ syndical : pratique privilégiée pour améliorer le quotidien, elle est en outre au cœur de l’utopie syndicaliste révolutionnaire. Donc, du dépassement du capitalisme.
Au fil du temps, la centralité de la grève dans les rapports sociaux s’est solidement installée, mais sa fonction utopique a vacillé. À la charnière des XXe-XXIe siècles, à l’instar des formes d’expression de la lutte des classes dont elle est l’une des quintessences, la pratique conflictuelle a même été nettement dévalorisée.
LA GRÈVE OU LE DÉRÈGLEMENT DE L'ORDRE DOMINANT PAR LES TRAVAILLEURS EUX-MÊMES
Outre sa dimension d’outil de défense des conditions d’existence et d’offensive pour des droits nouveaux, la grève est est une forme primitive d’agglomération du monde ouvrier, dont la montée en puissance précède puis accompagne le développement du syndicalisme.
Lorsque le droit de se regrouper dans des syndicats est accordé en 1884, les conflits du travail, dépénalisés en 1864, ont déjà bien entamé leur processus d’installation au cœur des relations industrielles. Autrement dit, l’action précède l’organisation. Souvent même, tout au long du XIXe siècle, elle la fonde : des syndicats naissent à la faveur d’une confrontation sociale, certains disparaissent rapidement une fois la grève terminée, d’autres perdurent.
Puis lorsque naît la CGT à Limoges en 1895, elle ne tarde pas à se doter d’un corpus de valeurs assis sur l’« autonomie ouvrière » et l’« action directe ». Par ses propres luttes, indépendamment des structures partisanes et des institutions, la classe ouvrière est censée préparer la « double besogne » définie par le fait syndical, soit tout à la fois le combat revendicatif prosaïque du moment et la perspective utopique d’un renversement du capitalisme. Une telle approche octroie à la grève un rôle central et tend à la parer de toutes les vertus.
Elle est envisagée comme une école de la solidarité, par l’entraide matérielle qu’elle induit souvent ou par son processus d’extension interprofessionnelle. Elle est en outre une école de la lutte de la lutte des classes, un « épisode de guerre sociale », comme a pu l’écrire l’un des dirigeants de la CGT d’avant 1914.
C’est la raison pour laquelle, quoi qu’il advienne : « ses résultats ne peuvent être que favorables à la classe ouvrière au point de vue moral, il y a accroissement de la combativité prolétarienne… ». Et si elle est victorieuse, elle est une forme de reprise collective sur le capitalisme, car elle produit « une diminution des privilèges de la classe exploiteuse… »
Enfin, pensent les syndicalistes révolutionnaires, la grève dans sa version généralisée offre aux ouvriers l’arme qui leur permettra d’atteindre le Graal : la disparition définitive du capitalisme. C’est ce que soutient le seul ouvrage qui, dans le champ militant, décrit par le menu ce processus d’appropriation des moyens de production par les travailleurs eux-mêmes, sous l’égide de leurs syndicats qui entreprennent ensuite d’organiser les lendemains qui chantent.
Cette grève générale à forte intensité politique n’est jamais advenue et n’a jamais donné lieu à un changement radical de société. Mais une telle utopie n’était pas forcément à but prémonitoire. Sa fonction était aussi, et peut-être surtout, de prémunir le mouvement ouvrier contre les sirènes de la cogestion et de l’accompagnement du système en place, projet formé pour lui, dès les dernières décennies du XIXe siècle, par les élites républicaines. Accessoirement, le maintien d’un cap révolutionnaire apparaît propice à nourrir une « grande peur » de l’ordre dominant qui, pour se rassurer, se sent ainsi acculé à faire des concessions.
LA GRÈVE, DE L'EDEN DE LA LUTTE DES CLASSES AU PURGATOIRE DU "DIALOGUE SOCIAL"
Alors que la Première Guerre mondiale donne le coup de grâce au syndicalisme révolutionnaire, deux grandes approches de la grève prédominent au cours des années de scission de la CGT (1922-1935). Pour la confédération de Léon Jouhaux, la suspension de la production est pour l’essentiel et sans s’en priver, un ultime recours ne devant être actionné que si la négociation est infructueuse. Pour la CGTU, proche du PCF, elle peut être une arme allant au-delà de la seule satisfaction des revendications économiques.
Selon les syndicalistes communistes : « dans son développement, la grève devient inévitablement une lutte politique mettant aux prises les ouvriers et la trinité : patronale, gouvernementale et réformiste, démontrant la nécessité d’une lutte impitoyable débordant le cadre corporatif ».
Pour autant, dans le discours et l’imaginaire du syndicalisme, la grève n’est plus de la même manière qu’auparavant une pratique susceptible d’œuvrer au principe d’« autonomie ouvrière » ou de provoquer l’accouchement d’une nouvelle société. Elle a perdu sa dimension utopique.
Son usage n’en demeure pas moins alors une arme majeure. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le syndicalisme et le monde ouvrier ne sont pas encore pleinement intégrés aux sociétés occidentales ; le processus est certes en route, mais non encore abouti. Bien que se banalisant peu à peu, la négociation collective a du mal à trouver sa place. Les organisations de travailleurs doivent donc s’appuyer sur une culture de lutte, seule ou presque à même de permettre une amélioration du quotidien et de perturber momentanément le système d’exploitation capitaliste.
Par la suite, et jusque dans les années 1960-1970, la grève demeure très présente dans les pratiques syndicales, pour des motifs qui diffèrent là encore sensiblement de ceux des périodes précédentes. Dans le cadre du « compromis fordiste » (l’échange gains de productivité contre pouvoir d’achat) et de l’institutionnalisation du syndicalisme, elle devient avant tout un moyen de gérer les dérèglements du système, de favoriser un partage un peu moins inéquitable des richesses, dans une logique de régulation conflictuelle des rapports sociaux. L’acte de cessation du travail se ritualise, comme l’illustre la pratique exponentielle des journées d’action.
De surcroît, dans le cadre des États sociaux bâtis au cours des Trente glorieuses, la France et le monde occidental connaissent une phase de réformes de progrès qui, en apparence, ne résultent pas systématiquement et à tout moment d’un rapport de force déclaré. Il est permis de penser qu’à terme, cette situation porte en elle une partie des racines de l’essoufflement de la légitimité de la pratique gréviste. Dès lors qu’une amélioration des conditions d’existence paraît devenir possible sous l’action du champ politique ou par des compromis décidés avec les syndicats dans le cadre d’un « dialogue social » appelé à prospérer, une évolution susceptible d’ériger la grève au rang de nuisance ou d’accident à éviter est prête à s’enclencher.
C’est alors que les organisations de salariés et leurs pratiques sont confrontées, entre autres, aux effets de la conjoncture (ralentissement de la croissance, désindustrialisation, précarisation du travail, individualisation des salaires, contre-réformes sociales disloquant les États sociaux, etc.), à la montée en puissance du libéralisme, dont l’un des desseins est de paralyser l’action syndicale, ou encore aux changements de société post-68 (montée de l’individualisme, déclin des grandes utopies politiques, des idéologies, etc.).
Il faut ajouter à cette liste des causes endogènes, celles fabriquées par le syndicalisme lui-même, parmi lesquelles sa distanciation vis-à-vis du champ politique et de son rôle en matière, son impuissance à fabriquer de l’espoir et de l’utopie, ainsi que les contradictions soulevées par son essence de contre-pouvoir institutionnel, tiraillé entre une obligation d’opposition et une profonde inclusion dans la société.
DÉLÉGITIMATION DE L'ACTION GRÉVISTE
Dans ce contexte, le mouvement syndical du tournant des XXᵉ-XXIᵉ siècles semble s’être significativement replié sur une stratégie de survie. Celle-ci paraît consister à sauver sa légitimité, si nécessaire en s’éloignant de la mise en action du salariat et, au final, en délaissant la manière de penser la rupture avec l’ordre capitaliste.
Depuis trente ou quarante ans, les unes après les autres et à des degrés divers, les grandes confédérations se sont en outre engagées dans une voie nourrissant un doute, voire une forme de délégitimation rhétorique de l’action gréviste.
On peut citer la fameuse phrase du dirigeant de la CFDT, Edmond Maire, comme archétype de la démarche de dévalorisation du rapport de force : « […] La vieille mythologie selon laquelle l’action syndicale, c’est seulement la grève, cette mythologie a vécu. Le syndicalisme doit l’abandonner. »
Pourtant, le syndicalisme de « dialogue social » sans rapport de force n’a jamais davantage porté ses fruits que celui de confrontation, loin s’en faut. Dans notre pays, les grandes phases historiques de conquêtes sociales majeures résultent de mobilisations syndicales et populaires. Le Front populaire, la Libération, mai-juin 1968 en sont d’éclatantes démonstrations. A contrario, depuis les années 1980, caractérisées par le développement des processus de négociation collective décentralisés et voulus à froid, la restriction du domaine des droits sociaux progresse continûment. Sauf, exceptionnellement, comme en novembre-décembre 1995, lorsqu’un mouvement social déterminé, en l’espèce bloquant et reconductible, parvient à se déployer tout en suscitant des débats de société à même d’établir la jonction entre le contenu des revendications professionnelles et les choix de société qu’elles permettent de mettre au jour.
Au long de son histoire, c’est à la fois par le projet politique utopique dont il était l’initiateur ou le vecteur et par la pratique gréviste dont il faisait un paradigme majeur de son action que le syndicalisme a rassemblé et s’est érigé en force sociale crainte d’un ordre dominant qui, aujourd’hui comme hier, ne concède quasiment jamais rien sans se sentir menacé.
Crédits : Pascal Pavani / AFP.
> Lire l’article original <
Cet article est extrait de "L’autre voie pour l’humanité. Cent intellectuels s’engagent pour un post-capitalisme", ouvrage sous la direction d’André Prone, Paris, Delga, 2018.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Retrouvez notre sélection d'articles dans le dossier "The Conversation : Normandie, terrain de recherche".