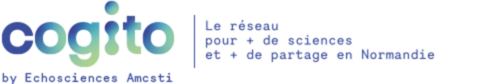"Il ne faut jamais cesser de croire en soi"
Publié par Guillaume Dupuy, le 30 juillet 2021 2.6k
Médecin, professeure, chercheuse, cheffe de service hospitalier, … À 58 ans, Astrid Vabret, ambassadrice de la 30ème Fête de la Science en Normandie, a déjà vécu plusieurs vies en une. Un parcours ponctué de belles rencontres mais aussi de difficultés qui auraient pu lui donner envie de s’arrêter. Au contraire, la chercheuse a poursuivi sa route, a franchi chaque obstacle et saisi chaque opportunité en ne cessant de se répéter : “Je peux y arriver !”
Astrid Vabret est comme sur ce portrait. Pleine de vie, d’énergie. Il émane d’elle une force tranquille, même si elle s’en défend : “Je ne suis pas forte mais je connais mes fragilités”. Une qualité qui a certainement été indispensable à cette chercheuse qui, au début des années 2000, a choisi de consacrer ses recherches aux coronavirus humains alors que toute sa profession se consacrait au HIV et au virus de l’Hépatite C. Une carrière à contre-courant sur laquelle l’ambassadrice régionale de la Fête de la Science 2021 a accepté de revenir au cours d’une conversation de plus de trois heures. Trois heures au cours desquelles il a été question de motivation, d’enthousiasme et d’engagement. Des valeurs chères à cette fille d’agriculteurs qui s’imaginait ingénieure des eaux et forêts. Elle suit pourtant des études de médecine. Des années “riches et difficiles”, selon ses propres mots, “mais où l’on rencontre des gens impressionnants”. Les rencontres, le mot-clé de ce portrait et le fil rouge d’un chemin qui l’a amené en mars 2020, après plus de vingt ans dans l’ombre, sous le feu des projecteurs.
Plateaux télévisés, interviews à la radio ou dans la presse, vous avez été très présente dans les médias depuis le début de la crise du coronavirus. Comment avez-vous vécu cette mise sous les projecteurs ?
La médiatisation, c’est compliqué. J’étais parfois appelée par les médias, notamment pour la rougeole, mais c’est vrai que les choses se sont intensifiées depuis mars 2020. On peut très rapidement se faire piéger. Plus on répond, plus on est sollicité. Surtout que, au début de la pandémie, nous étions très peu à connaître les coronavirus. J’ai donc accepté de nombreuses invitations mais je me suis vite aperçu que cela pouvait me prendre beaucoup de temps. Ma priorité, c’est mon équipe et nous étions débordés à cette période. J’ai donc régulé. J’ai fait des choix, en privilégiant toujours les échanges directs avec le public.
Vous aimez échanger, partager avec les publics ?
Bien sûr. Je ne suis pas professeure pour rien [sourire, ndlr]. Il faut prendre le temps de répondre pour que les publics osent poser des questions. D’ailleurs, je suis toujours très impressionnée par ces questions. Même si tout le monde n’a pas les connaissances pour tout comprendre dans les détails, il y a une forme de “bon sens”. En fait, les publics ne sont pas si étrangers à la démarche scientifique qu’on veut bien le dire.
On a pourtant beaucoup parlé du manque de culture scientifique de la population, notamment lorsqu’il a été reproché à la recherche de ne pas aller assez vite. Vous pensez donc le contraire ?
Je vis avec des footeux. Moi, ça ne m’intéresse pas et lorsqu’il y a un match où une équipe est réputée plus forte que l’autre, j’ai tendance à me dire que c’est plié mais on me dit toujours : “Tant que le match n’est pas joué, on ne peut pas savoir”. Pour la recherche, c’est pareil. On peut faire des hypothèses, faire des modélisations mais on ne peut pas savoir à l’avance ce qui va réellement se passer. C’est une chose qui a été beaucoup reprochée aux politiques.
Là aussi, il y a eu beaucoup de confusion entre le rôle des chercheur·se·s et des élu·e·s dans la gestion de cette pandémie. Y avez-vous été confrontée ?
Il y a eu des confusions. On m’a parfois questionné sur des sujets auxquels je ne pouvais pas répondre, comme de savoir s’il fallait réouvrir les écoles ou non. Ça, c’est un choix politique. On a aussi tenté quelquefois de connaître mon point de vue personnel. En tant que scientifique, notre rôle n’est pas de donner notre opinion, elle n’a aucune importance. Nous sommes là pour fournir un avis, une expertise basée sur nos observations, pour que les élu·e·s puissent prendre des décisions.
C’est vrai que beaucoup de données et de chiffres ont été diffusés depuis plus d’un an maintenant.
Le chiffre, c’est intéressant. C’est impactant. Dès que vous donnez un chiffre, il y a un semblant d’exactitude, de vérité. Pourtant, il n’y a rien de moins vrai qu’un chiffre. J’ai le souvenir d’une conférence de presse de Boris Johnson où il expliquait qu’il ne pouvait pas contrôler la pandémie parce que le variant Alpha était 40 à 70% plus contagieux que le virus initial. Je me suis dit : “Quelle belle reprise politique !”. Parce qu’au fond, 40 à 70%, c’est beaucoup ou pas ? Il faut interpréter les chiffres, leur donner un contexte significatif pour savoir s’ils sont petits ou grands. 50% de rien, c’est toujours rien.
Les données ont donc été manipulées ?
Disons que sur le coup, j’ai trouvé son discours plutôt gonflé. Il fallait trouver un coupable mais, même si les variants sont plus transmissibles, ils ne sont pas plus résistants aux mesures barrières. La responsabilité est partagée dans la dynamique épidémique et notre comportement est primordial. Avec les virus, il faut frapper fort, même si c’est contraignant. Il faut être rigoureux pour limiter leur dissémination et l’apparition de nouveaux variants.
Nous devons donc nous attendre à voir apparaître de nouveaux variants ?
Le virus va évoluer, ce n’est pas un scoop. On a expliqué au début de la pandémie qu’il était relativement stable mais c’est normal : quand vous n’avez pas de raison de changer, vous ne changez pas. Les premiers variants d’intérêt ont émergé au bout d’un an parce que la pression s’est faite plus forte sur le virus : plus de gens infectés, plus de gens vaccinés. Les virus sont comme de l’eau, ils trouvent toujours leur chemin. Après, l’évolution des virus ne nous est pas toujours défavorable. Il y a beaucoup de personnes pour qui “virus” est synonyme de maladie mais c’est parce qu’elles ne savent pas l’intimité que nous avons avec ces organismes. Ils sont partout dans nos cellules. 8 à 10% de nos gènes sont issus de virus qui ont été intégrés par nos ancêtres, comme celui responsable de la production du placenta. Nous sommes des chimères.
C’est la découverte de toutes ces choses insoupçonnées qui vous a amenée à vous spécialiser en virologie ?
C’est une rencontre. Après une première année d’Internat à Brest, en médecine interne, et une seconde à Caen, en biologie, j’ai tout arrêté pendant deux ans pour partir en bateau. Un projet de longue date que j’avais avec mon ex-mari passionné de voile, François Vabret. C’est à mon retour que j’ai rencontré le Professeur Freymuth, un autre François. Il était déjà très reconnu au niveau national et international mais il évoluait dans une spécialité, la virologie respiratoire, qui intéressait peu. Toute la profession se concentrait sur le Sida et l’Hépatite C. C’est lui qui m’a emmenée là où je suis aujourd’hui. Il y a des gens comme ça, une maîtresse d”école, un professeur, qui parviennent à vous communiquer quelque chose et que l’on a envie de suivre.
Vous le présentez comme votre mentor. Que vous a-t-il appris ?
Il m’a appris l’enthousiasme. Quand vous menez une thèse, que vous faites de la recherche ou que vous êtes chef·fe de service, c’est très important d’avoir ce moteur intérieur, cette capacité à générer de l’énergie pour vous et pour les autres. Lorsque j’étais en difficulté, il me disait : “Astrid, il n’y a qu’une chose qui compte, c’est ce que l’on fait et ce que l’on fait, c’est grâce à notre motivation.” Mon père aussi était comme ça. Un agriculteur qui croyait en la valeur du travail. Encore un François. Alors peut-être avais-je déjà cette force en moi sans le savoir et que le Professeur Freymuth me l’a simplement révélée. En tout cas, je l’ai pris comme un don phénoménal et j’essaye aujourd’hui de le transmettre à mes étudiant·e·s en leur disant : “On peut se tromper, on peut toujours se tromper, mais il faut toujours croire en vous”.
Le choix des coronavirus comme sujet de thèse, c’est aussi lui ?
Oui. Il a eu cette intuition.. Il m’a simplement dit : “J’ai un sujet de thèse pour vous”. Je lui ai demandé s’il était sûr et il m’a répondu : “Astrid, ça va arriver”, et c’est arrivé. J’ai commencé ma thèse en 2000, trois ans plus tard la pandémie de SRAS frappait l’Asie. Ce que j’ai aimé dans ce travail, c’est qu’il y avait tout un sujet à défricher. Cela m’a donné un sentiment de liberté, une envie de découverte. Il y avait aussi peu de compétition puisque la virologie respiratoire n’intéressait pas grand monde mais il n’existe pas de situation où l’on aurait tous les avantages.
Au fond, est-ce que vous n’aimez pas aller à contre-courant ?
Être à contre-courant, c’est une chose que j’ai appréhendé très tôt parce que je suis née gauchère dans une génération où l’on nous obligeait à écrire de la main droite. Mon instituteur voyait bien que j’étais contrariée et m’a raconté son histoire. Il était lui-même gaucher mais avait choisi de retourner la situation à son avantage jusqu’à devenir parfaitement ambidextre. Je l’ai écouté et aujourd’hui encore, lorsque je suis face à une situation difficile, je me pose cette question : qu’est-ce que je peux faire pour ne pas subir ?
Cela demande une grande force morale…
Ce n’est pas une force, c’est une capacité à se rappeler que l’on peut agir et que l’on peut parfois y arriver. Au Salon de l’étudiant, j’ai toujours été frappée de rencontrer des jeunes qui ont envie mais qui doutent et je leur dis : “Vous devez trouver votre motivation !”. La motivation, c’est primordial. On ne peut pas avancer si l’on est plombé par l’idée que l’on est moins bien que l’autre. C’est le rôle des parents d’aider leurs enfants à prendre conscience de leurs potentiels, de leur capacité à gérer les choses. Moi, quand je suis arrivée de ma campagne pour débuter mes études de médecine, j’avais ça : je savais que je pouvais y arriver.
La place des femmes dans la recherche est une question qui revient régulièrement dans l’actualité. Pouvez-vous nous parler de votre expérience ?
J’ai été invitée il y a quelques temps à participer à une table ronde à l’occasion de la Journée des droits de la femme. L’animatrice m’a demandé de repenser à mes études de médecine et c’est vrai qu’avec du recul, en repensant à certains comportements, on se dit : “Waouh ! Ils s’en permettaient des choses !”. Pour autant, je n’ai pas souffert de cette situation. J’avais l’exemple de mon père, je savais qu’il existait d’autres types d’hommes. J’en ai rencontré tout au long de ma carrière. Des hommes qui avaient des pouvoirs et qui me les ont transmis, Il y a eu François Freymuth et puis le Président de ma section au Conseil national universitaire. J’y suis entrée lorsque la parité a été instaurée, je faisais partie des quotas. Aujourd’hui, j’occupe son poste parce qu’il a vu quelque chose en moi. Je lui suis très reconnaissante. J’ai été gâtée et j’en ai profité à fond même si j’ai longtemps ressenti le syndrome de l’imposteur.
Vous doutez donc parfois ?
C’est humain. Quand ça fonctionne, on se dit “Pourquoi moi ?”. Je connais mon travail mais je reconnais aussi celui des autres, leur engagement. J’adore l’engagement, les choses lentes qui se construisent dans le temps.
Voilà qui contraste beaucoup avec l’urgence de notre époque…
Je suis très frappée par ces personnes qui veulent tout, tout de suite. Dans mon métier de virologue, il n‘y a qu’une seule urgence : la qualification des dons d’organes, parce que nous n’avons que six heures pour donner nos résultats aux équipes de greffe. Pour le reste, il y a surtout des gens pressés. Dans cette crise, on a entendu dire : “Un an, c’est long”. Mais qu’est-ce que c’est un an ou même deux à l’échelle d’une vie ?
Nous sommes trop impatients ?
Le temps long, le mérite font partie des valeurs que m’ont transmises mes parents. Je sais que ce que l’on acquiert difficilement procure un bonheur plus grand. Je mesure aussi le fait que le travail scientifique, en général, c’est long. C’est déprimant aussi parce les expérimentations ne fonctionnent pas toujours. La recherche réhabilite le droit à l’erreur. L’erreur fait partie de la vie et c’est un moteur très puissant. D’ailleurs, les mutations constituent des erreurs pour les virus et l’on voit bien que, parfois, elles leur donnent un avantage. L’important, c’est donc bien le voyage, pas la destination… Il y a des gens qui réussissent facilement mais finalement, ils n’apprennent peut-être pas grand-chose. C’est un reproche que l’on a beaucoup fait aux études de médecine, d’être difficiles parce qu’il fallait apprendre beaucoup de choses. Quand mes étudiant·e·s me demandent : “Pourquoi on apprend ça, ça ne sert à rien”, je leur réponds : “Ça sert toujours à quelque chose d’apprendre parce que chaque information ouvre sur quelque chose d’autre”.
Il y a la connaissance, il y a aussi la reconnaissance. Vous faites partie de la promotion 2021 de la Légion d’honneur que vous allez d’ailleurs recevoir à l’occasion de la Fête de la Science. Qu’avez-vous ressenti lorsque vous l’avez appris ?
Nous sommes six virologues dans cette promotion alors je dirais que ça m’a fait plaisir pour moi mais surtout pour ma spécialité. La virologie est une discipline discrète. Avant cette pandémie, peu de gens savaient qu’elle existait. Maintenant, si l’on prend le périphérique, on peut lire “Pandémie de coronavirus” sur les panneaux électroniques. Si je m’étais doutée de ça il y a 20 ans lorsque tout le monde me demandait pourquoi je travaillais sur ce sujet…
Et dans 20 ans justement : comment vous projetez-vous dans l’avenir ?
J’ai maintenant deux petites-filles, c’est ma grande joie et c’est une découverte. À 58 ans, je me dis qu’il faut que je ménage ma sortie. L’avenir appartient aux esprits jeunes, ce sont eux qui ont de nouvelles idées. Une fois que la crise sera passée, je veux faire en sorte que mon laboratoire tourne, prendre du plaisir, vivre des choses intenses. Je veux travailler sur des sujets qui m’intéressent. Mon équipe va prochainement s’agrandir avec un évolutionniste et un spécialiste des coronavirus de chauve-souris venu du Muséum national d’histoire naturelle. La multidisciplinarité, la santé globale, le “One health”, … Ça, ça me motive. Un spécialiste des chauve-souris ? Notre monde est connecté, et pas seulement virtuellement. Qui peut s’imaginer qu’un virus qui émerge à un bout de la planète n’aura pas d’impact sur nous ?
Après cette pandémie, plus personne…
Nous vivons dans une société qui classe alors que nous sommes polyvalents. Un jour, j’ai entendu Yann Moix dire : “Moi, je suis littéraire, je ne comprends pas pourquoi on m’a obligé à faire des mathématiques”. Il m’a énervé. Bien sûr qu’il faut faire des maths ! Je suis contre le fait de séparer les gens en littéraires et scientifiques. Pour moi, la vie c’est un truc foisonnant. On a le droit de toucher à tout, en sachant que cela devient intéressant lorsque l’on s’engage.
Annonces, appels à candidatures, rendez-vous, trucs et astuces, ... Suivez toute l'actualité de la 30ème Fête de la Science dans notre dossier spécial "Fête de la Science 2021".