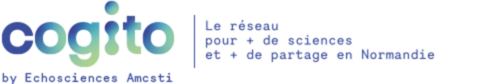"Faire du droit un outil vivant"
Publié par Guillaume Dupuy, le 4 septembre 2025 630
Enseignante-chercheuse en droit privé à l'université de Caen Normandie, Amandine Cayol explore la personne humaine à l’ère du transhumanisme et de l’IA. Ambassadrice de la Fête de la Science 2025 en Normandie, elle milite pour un droit vivant, accessible et ancré dans les enjeux contemporains.
Amandine Cayol incarne une nouvelle manière de faire du droit : ancrée dans les réalités sociales et scientifiques, curieuse des autres disciplines, soucieuse de transmettre. Que ce soit à travers ses recherches sur le transhumanisme et l’intelligence artificielle, son engagement pédagogique ou son rôle d’ambassadrice de la Fête de la Science, elle montre que le droit est un levier pour penser, construire et encadrer le monde de demain.
Amandine, bonjour. Vous avez accepté d’être l'ambassadrice de cette 34ème Fête de la Science en Normandie aux côtés de Zoé Lambert. Merci. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Bien sûr. Je suis enseignante-chercheuse en droit privé au sein de l’Institut caennais de recherche juridique (ICReJ) à l’université de Caen Normandie depuis 2011. Avant cela, j’ai passé un an comme contractuelle à l’université du Havre Normandie, ce qui m’a permis de garder un fort ancrage dans le Laboratoire d'études en droits fondamentaux, des échanges internationaux et de la mer (LexFEIM) où je reste très active encore aujourd’hui.
Encore peu de personnes savent que le droit est un sujet de recherche. En quoi cela consiste-t-il
La recherche en droit peut revêtir plusieurs formes. Dans une approche classique, elle consiste à analyser les règles existantes, à les expliciter, les organiser, voire les repenser pour améliorer la cohérence du système juridique. Mais il existe aussi une dimension plus prospective, que je trouve particulièrement stimulante : il s’agit alors d’anticiper les changements sociaux, technologiques ou médicaux et de réfléchir à la manière dont le droit peut y répondre. Cela peut vouloir dire poser des limites ou, au contraire, accompagner une évolution de la société.
-
RENDEZ-VOUS ▶︎
"Procès d'un cyborg tueur : Quand la technologie franchit les limites, qui est coupable ?"
Comment résumeriez-vous vos domaines de recherche ?
Mes recherches s’articulent autour de la notion de “personne”, qu’elle soit “juridique”, c’est-à-dire sujet de droit, ou “humaine”, l’être de chair et de sang. Cette distinction, souvent méconnue, est pourtant fondamentale. On peut être une personne humaine sans être une personne juridique : avant la naissance, ou après la mort, par exemple.
Pourquoi ce thème central de la “personne” ?
Parce qu’il est à la croisée de nombreux bouleversements sociétaux, technologiques, médicaux… C’est un fil conducteur qui m’amène à explorer des sujets variés : bioéthique, propriété du corps, données personnelles, responsabilité médicale. La personne humaine est partout, même quand elle disparaît du champ de vision juridique.
Vous avez dirigé un projet de recherche sur le transhumanisme. Pourquoi ce choix ?
Le projet est né d’un échange avec ma collègue Émilie Gaillard qui est également enseignante-chercheuse en droit privé à SciencesPo Rennes et spécialiste en droit des générations futures. Elle est revenue bouleversée d’un événement à l’ONU où des militants transhumanistes prônaient la fusion homme-machine. Je dois avouer que je ne connaissais pas grand-chose à ce sujet à cette époque mais cela interrogeait le rapport au corps, et donc la personne, alors je me suis dit “Pourquoi pas ?”. On a voulu comprendre ce mouvement, en saisir les enjeux, sans caricature. Cette aventure de 2 ans (2019-2021) a été révélatrice pour moi sur la façon d’imaginer le droit de manière prospective… et la nécessité d’aller sur le terrain aussi.
Quels en étaient les enjeux juridiques ?
On s’est demandé : faut-il accorder la personnalité juridique à des robots ou cyborgs ? Comment adapter nos systèmes de responsabilité ? Comment protéger le corps, mais aussi l’esprit humain, face aux technologies ? Comment repenser les droits et libertés fondamentaux face au développement des idées et réalisations transhumanistes ? Le droit peut interdire, encadrer, ou accompagner. Mais il ne décide pas seul. Ce sont des choix éthiques et politiques.
Vous travaillez aujourd’hui sur l’IA. Quels sont les sujets qui vous mobilisent ?
Je participe à plusieurs projets, dont un sur l’IA et la santé mentale avec des informaticien·ne·s ou encore sur les jumeaux numériques [représentation virtuelle conçue pour refléter avec précision un objet physique tel qu’un bâtiment ou un corps humain, ndlr] pour le traitement du cancer. Je suis souvent la seule juriste dans ces projets : mon rôle est de poser les questions du cadre légal, du respect des droits, de la protection des données et du statut de l’IA.
Justement, faut-il donner une personnalité juridique aux IA ?
La question a été sérieusement débattue au niveau européen… mais aujourd’hui, la réponse est non. Les vrais enjeux sont ailleurs : encadrer son usage, prévenir les discriminations, protéger les pensées — notamment avec les données cérébrales. Ces dernières ne sont pas encore en tant que telles juridiquement reconnues comme sensibles si elles ne peuvent pas entrer dans la catégorie des données de santé, ce qui est problématique.
-
RENDEZ-VOUS ▶︎
"Procès d'un cyborg tueur : Quand la technologie franchit les limites, qui est coupable ?"
Vous travaillez donc avec de nombreux autres domaines de recherche. Quelle est la place pour cette transdisciplinarité dans vos projets ?
Indispensable. Il faut travailler avec des informaticien·ne·s sur le numérique, avec des biologistes et des médecins en santé. Il faut aussi savoir dépasser les frontières, aller à la rencontre des collègues à l’étranger pour voir d’autres systèmes juridiques, d’autres façons de penser le droit. En matière de santé, d’éthique, de numérique, aucun·e juriste ne peut prétendre penser seul·e.
Comment voyez-vous le rôle du droit dans ces échanges ?
Le droit, c’est ce qui permet de relier l’innovation à la société. C’est ce qui met des limites, structure, sécurise. Mais il doit rester vivant, en dialogue constant avec les autres disciplines.
Puisque l’on parle d’échange, vous avez récemment relancé la Clinique juridique de Normandie avec l’enseignante-chercheuse en droit public, Maria Castello. En quoi consiste-t-elle ?
C’est un dispositif pédagogique où les étudiant·e·s s’engagent volontairement sur des projets concrets — sans note, sans crédits. Ils rédigent des articles pour “Les Surligneurs” et “Village de la justice”, tiennent des permanences juridiques avec le Conseil départemental de l'accès au droit (CDAD 14) ou mènent des projets de recherche appliquée avec des associations. Elles et ils ont, par exemple, organisé le procès fictif d’un cyborg tueur lors de la Fête du droit et travaillé avec la Fondation des femmes sur une proposition de loi mémorielle autour de l’IVG qui a été réellement déposée par la sénatrice Laurence Rossignol. Ça a été génial pour les étudiant·e·s !
Justement, quel est l’impact de ce dispositif sur les étudiant·e·s ?
Il apporte une vision concrète de ce qu’est le droit. Lorsque j’ai commencé à enseigner à l’université, les premières réactions des étudiant·e·s c’étaient : “Mais madame, à quoi ça sert ce que l’on est en train d’apprendre ?”. Ce questionnement est resté ancré en moi et nous avons tenté de proposer une réponse en proposant une forme de pédagogie inversée au sein de la Clinique juridique. Elles et ils y découvrent que le droit n’est pas figé. Qu’il y a toujours plusieurs pistes, qu’on peut défendre des positions opposées avec des arguments valides. Ça bouscule leurs habitudes d’apprentissage. Et ça crée un esprit de promo, une vraie solidarité inter-niveaux entre L1, L2, L3 et M1.
Et sur vous ?
La Clinique juridique a bousculé ma manière d’enseigner. J’ai été impressionnée par ce que les étudiant·e·s, même en première année, sont capables de produire lorsqu’on leur fait confiance et qu’on les place en situation active. Elles et ils savent chercher, raisonner, collaborer et, surtout, sortir du simple apprentissage par cœur. Je me rends compte qu’on n’ose pas assez les faire agir tôt dans le cursus, les confronter à des problématiques concrètes et les inviter à construire leur propre réflexion. Et pourtant, elles et ils en sont tout à fait capables !
-
RENDEZ-VOUS ▶︎
"Procès d'un cyborg tueur : Quand la technologie franchit les limites, qui est coupable ?"
Vous avez accepté le rôle d’ambassadrice de la Fête de la science. Qu’est-ce qui vous a motivé ?
Parce que le droit est partout, mais reste mal compris. On le pense inaccessible, réservé aux spécialistes. En réalité, c’est un outil du quotidien : acheter une baguette, c’est conclure un contrat ! Il faut faire découvrir aux citoyen·ne·s que le droit les concerne, qu'elles et ’ils peuvent le comprendre et même participer à des réflexions sur son évolution, notamment dans le domaine de la bioéthique.
Comment faire passer ce message ?
En vulgarisant, en intervenant dans les évènements tels que la Fête de la Science, dans les médias, dans les formations, auprès des ingénieur·e·s, des médecins, des citoyen·ne·s. Quand on explique simplement, ça intéresse tout le monde. Et ça montre aussi aux chercheur·se·s et étudiant·e·s que le droit est un outil vivant, évolutif, en prise avec le réel.
Crédits : Université de Caen Normandie (DR).
Annonces, appels à candidatures, rendez-vous, trucs et astuces, ... Suivez toute l'actualité de la 34ème Fête de la Science dans notre dossier spécial "Fête de la Science 2025".